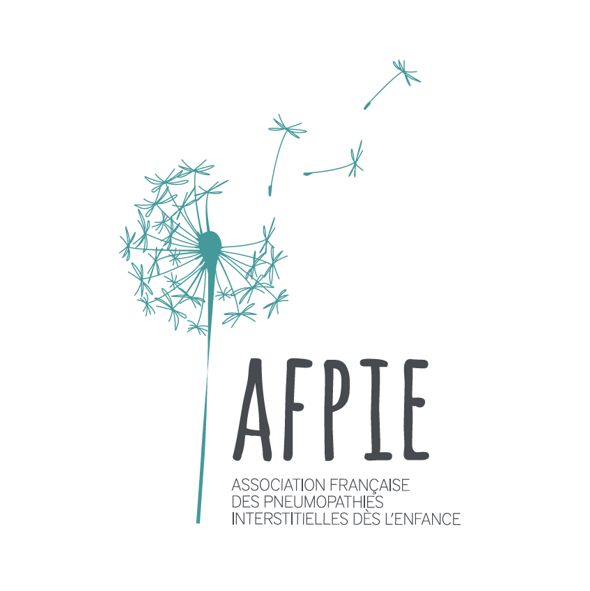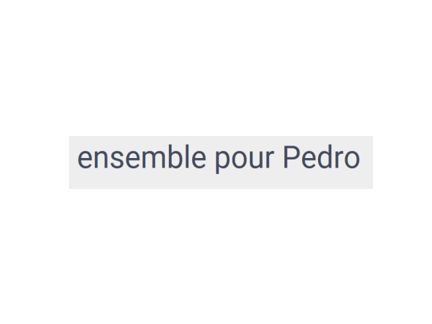Présentation de la maladie
Qu’est-ce que le surfactant pulmonaire ?
Le surfactant pulmonaire est une substance complexe qui permet le maintien de l’ouverture des alvéoles pulmonaires. Il est donc indispensable à une respiration normale, avec une bonne captation de l’oxygène et une bonne élimination du dioxide de carbone (ou gaz carbonique). Les poumons commencent à produire du surfactant environ 4 mois avant la naissance à terme et des quantités suffisantes ne sont présentes que 4 à 6 semaines avant cette naissance. Les grands prématurés reçoivent souvent du surfactant artificiel pour faciliter leur respiration.
La formation de surfactant pulmonaire est un processus complexe qui comprend successivement la synthèse de plusieurs composants, leur assemblage, l’acheminement du surfactant à la surface des alvéoles et sa disposition adéquate à la surface de ces alvéoles. Le surfactant secrété est également régulièrement renouvelé, avec des mécanismes de récupération du surfactant en excès. Plusieurs diagnostics peuvent affecter cette synthèse, aboutissant à une altération plus ou moins importante de la respiration, parfois dès la naissance. Les signes faisant évoquer ce diagnostic sont donc variables, mais ont en commun des difficultés respiratoires, qui peuvent être modestes ou au contraire très sévères. Il peut s’agir :
- De détresse respiratoire néonatale, pouvant nécessiter une prise en charge en réanimation
- D’accélération du rythme respiratoire, avec des signes de rétraction du thorax et un battement des ailes du nez
- De difficultés aux prises alimentaires et de ralentissement de la prise de poids
- De toux régulière
- De baisse du taux d’oxygène dans le sang, mesurée par le médecin ou se traduisant par des lèvres moins bien colorées ou bleutées (cyanose), ou encore par un bombement des ongles (hippocratisme digital)
La radiographie de thorax est anormale et le scanner confirme des images interstitielles et alvéolaires.
Quelles sont les origines et causes possibles de cette maladie ?
Plusieurs anomalies génétiques sur des protéines qui participent à la composition du surfactant ou à son transport sont responsables de pathologies du surfactant. Les déficits en protéines du surfactant représentent environ 10 % de toutes les maladies pulmonaires interstitielles de l’enfant.
Déficit en Protéine B du surfactant (SP-B)
SP-B est une protéine constitutive du surfactant. Le déficit en SP-B est dû à des mutations héréditaires du gène de la protéine B du surfactant (SFTPB) sur le chromosome 2, qui entraînent une absence partielle ou totale de protéine B du surfactant. La gêne respiratoire est très importante, débutant dans les heures suivant la naissance, nécessitant une ventilation assistée et n’étant pas améliorée par l’administration de surfactant. Le pronostic est mauvais, avec un décès précoce. Certains centres proposent une transplantation pulmonaire, dont la faisabilité doit être discutée avec la famille.
Déficit en ABCA3
ABCA3 est une protéine qui participe au transport du surfactant. Son déficit est lié à des mutations héréditaires du gène ABCA3 sur le chromosome 16. Les personnes atteintes ont des évolutions très variables, pouvant aller d’une détresse respiratoire néonatale très sévère à une découverte plus tardive dans l’enfance. Il s’agit d’une maladie autosomique récessive, ce qui signifie qu’un enfant doit hériter de deux copies d’un gène anormal (une de chaque parent) pour présenter des symptômes. Le pronostic est variable, en fonction de la gravité de la maladie.
Déficit en protéine C du surfactant (SP-C)
SP-C est une protéine constitutive du surfactant. La maladie est due à des mutations dans le gène de la protéine C du surfactant (SFTPC) sur le chromosome 8, induisant une accumulation de protéine C dysfonctionnelle dans les cellules pulmonaires. Une seule copie du gène anormal suffit pour occasionner des symptômes (maladie dominante). Cette maladie a une présentation très variable, allant de la détresse respiratoire aiguë à une maladie pulmonaire chronique à évolution plus lente. Elle peut toucher les nourrissons, les enfants et les adultes. Le pronostic est très difficile à prédire, car ne semble pas lié à la mutation responsable, et peut être très différent entre personnes d’une même famille. Une stabilisation, et même une amélioration avec le temps, est possible pour certains patients.
Déficit en facteur-1 de transcription de la thyroïde (TTF-1)
TTF-1 a plusieurs fonctions, dont l’activation des gènes associés au surfactant. Les mutations du gène de TTF-1 (NKX2.1) sur le chromosome 14 peuvent entraîner une maladie respiratoire, une hypothyroïdie et/ou des problèmes neurologiques. Les symptômes respiratoires dus à ces mutations sont variables en intensité, d’une détresse respiratoire néonatale à une maladie plus chronique dans l’enfance. Il s’agit d’une maladie autosomique dominante ; la plupart des mutations surviennent spontanément et ne sont pas héréditaires.
Comment le diagnostic est-il établi ?
Les différents examens réalisés vont permettre d’affirmer l’atteinte interstitielle et d’identifier la cause génétique.
Le scanner thoracique est l’examen radiologique qui permet d’affirmer l’atteinte interstitielle.
Certains aspects du scanner peuvent évoquer d’emblée une pathologie du surfactant, mais ce n’est pas toujours le cas. En fonction de l’âge de l’enfant et de l’aspect du scanner, différents examens vont permettre de rechercher les autres causes de syndrome interstitiel :
- Infection ou hémorragie intra-alvéolaire (fibroscopie avec lavage broncho-alvéolaire)
- Déficit de l’immunité ou auto-immunité (bilan sanguin)
- Maladie métabolique (bilan sanguin et urinaire)
Le diagnostic de déficit en protéine du surfactant est apporté par des tests génétiques, réalisés à partir d’une prise de sang, après accord des parents et de l’enfant (s’il est en âge de le donner). Le résultat de ces tests n’est le plus souvent pas disponible avant plusieurs semaines.
Quelles complications peuvent survenir ?
Le pronostic de la maladie pulmonaire est variable, en fonction de la gravité de la maladie. Le médecin référent peut donner les informations les plus adaptées à chaque cas précis. Dans les cas les plus sévères, une transplantation pulmonaire peut être envisagée. Il s’agit d’une décision difficile qui doit être discutée en lien avec le centre de transplantation.
Quels traitements existent pour la pathologie du surfactant ?
Il n’existe actuellement aucun traitement validé pour les déficits en protéines du surfactant. Pour les nouveau-nés atteints, l’administration de surfactant artificiel ne permet qu’une amélioration transitoire de l’état respiratoire, et est inefficace pour traiter le déficit sous-jacent. Une piste de recherche concerne l’utilisation des traitements modulateurs de la mucoviscidose dans certaines mutations sur le gène ABCA3.
Le traitement proposé est donc non spécifique, avec plusieurs objectifs :
- Permettre à l’enfant de mieux respirer : plusieurs traitements non spécifiques peuvent être proposés, comme des bolus de corticoïdes, de l’hydroxychloroquine ou des traitements immuno-suppresseurs. Une supplémentation en oxygène et/ou une respiration assistée par un ventilateur peuvent être nécessaires au long cours.
- Assurer des apports nutritionnels suffisants, pour permettre une bonne croissance et un bon développement. Lorsque l’alimentation spontanément prise par l’enfant n’est pas suffisante, des suppléments par sonde naso-gastrique ou par gastrostomie peuvent être nécessaires.
- Limiter le risque d’aggravation respiratoire à l’occasion d’infections virales ou bactériennes.
La prise en charge d’un enfant avec insuffisance respiratoire nécessite une équipe multi-disciplinaire experte, qui assure un lien étroit avec le médecin traitant. Une surveillance médicale spécialisée régulière est indispensable, ainsi que l’intervention de professionnels comme les kinésithérapeutes, orthophonistes, ou psychologues. Cette prise en charge au long cours est décrite dans un PNDS (en attente de mise en ligne) à paraître en 2025.